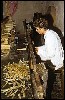Si vous n'avez pas le menu à gauche de l'écran, Cliquez ici
Sa situation limitrophe - le Haut-Jura est cerné par le lion de Franche-Comté, l'ours du pays bernois, la fleur de lis du royaume de France et la croix du duché de Savoie - vaudra à la "terre de Saint-Claude" une histoire agitée dont l'origine, selon l'auteur de La Vie des Pères du Jura, se situe au milieu du Ve siècle avec la fondation, par les frères Romain et Lupicin, du monastère de Condat - le sanctuaire gallo-romain de Villards d'Héria révèle que la présence humaine est, en réalité, bien antérieure. Rebaptisée Saint-Oyend-de-Joux, puis Saint-Claude, l'abbaye de Condat attire dans la région des colons qui entreprennent de défricher les hautes terres. Les pèlerins ne tarderont pas à suivre, alertés par les miracles de saint Claude, dont le corps sera découvert intact en 1160, cinq siècles après sa mort. Avec la décadence religieuse, la puissante abbaye perd en 1436 son statut de principauté.
Affaibli par l'épisode comtois de la guerre de Trente Ans et la peste, le Haut-Jura, malgré la résistance du capitaine Lacuzon, est envahi, au XVIIe siècle, par les troupes françaises. Annexé en 1678, il connaît de nouveau une certaine prospérité. Il se construit alors tant de maisons que les forêts s'épuisent ; on doit même recourir à la tourbe pour se chauffer. En 1742, l'abbaye est rattachée à l'évêché de Saint-Claude. Issues de la révolution industrielle, les coopératives ouvrières inspirent, à la fin XIXe siècle, les principes d'action sociale de l'"école de Saint-Claude", très active jusqu'à la Seconde Guerre mondiale (syndicats, caisses de prévoyance et de retraite...). Grâce à la diversité de ses activités de production, le Haut-Jura demeure une montagne habitée et vivante
![]()
La vallée de la Bienne.
Le bassin versant de la Bienne coïncide pratiquement avec le territoire du parc. La rivière prend sa source au pied du mont Fier et force le passage de la cluse de Morez. Longtemps bâties de moulins, de forges, de scieries, de clouteries et de tanneries, les rives de la Bienne sont aujourd'hui, autour de Morez, consacrées aux activités de précision : décolletage, lunetterie... En empruntant l'autorail de Morbier à Saint-Claude, on admirera, du haut des viaducs, la vue saisissante sur les gorges, fief des pêcheurs à la truite. Par le GR9, on pourra aussi quitter le pont de Villard-sur-Bienne pour atteindre Longchaumois, où la Maison de la flore donne un aperçu de la diversité de la végétation.
![]()
Aux portes de Saint-Claude, ce site classé est comme un livre ouvert où se retrouvent les formations géologiques jurassiennes les plus remarquables : une cluse profonde encadrée par la face striée de la Roche Blanche; un puissant anticlinal (les Grès) flanqué du célèbre plissement du Chapeau-de-Gendarme. D'anciennes scieries s'étagent au fil de la cascade des Moulins, qui, à partir de la Toussaint, ne voit plus le soleil pendant cinq mois. On doit la construction de l'audacieuse route en lacet de Septmoncel à l'action politique d'un enfant du pays, le jurisconsulte Désiré Dalloz (1795-1869). Le cours du Flumen rejoint plus loin la vallée encaissée du Tacon, qui prend sa source aux Bouchoux, site réputé pour ses qualités acoutisque
![]()
Flottable jusqu'en 1914 à l'aval de Molinges, la basse Bienne acheminait alors jusqu'à Lyon les radeaux de troncs d'épicéa chargés de blocs de marbre de Chassal, de balles de chêne et de noisetier d'Epercy, de tonneaux emplis d'objets en bois tourné de Vaux ou de fromages de Septmoncel. Aujourd'hui, la basse vallée de la Bienne participe à l'aventure industrielle de la "Plastics Vallée" qui se concentre autour d'Oyonnax.
LES RADELIERS : les radeaux étaient le poduit d'un assemblage de 7 à 8 grosses grumes (sapins ou chênes) ; celles-ci étaient destinées à être vendues.
Si les Mésopotamiens, radeliers avant l'heure, descendaient déja le Tigre et l'Euphrate sur des radeaux où prenait également place un âne ( bien apprécié pour la remontée ! ), dans le Jura, le métier s'est structuré au lendemain de la conquête française. Désireux de se constituer une flotte afin d'affronter l'Angleterre, Louis XIV avait besoin de bois de marine. Or la Franche-Comté était riche non seulement en sel, mais également en bois.
Un grand nombre de sapins et de chênes abatus dans les forêts jurassiennes empruntent ainsi les voies fluviales, assemblés en blocs de radeaux d'environ 35 m de long et de 5 à 6 m de large. Cinq à six personnes sont nécessaires pour conduire. Une fois leur marchandise parvenue à bon port, nos jurassiens doivent revenir à pied. Sur le chemin du retour, les auberges donnent parfois lieu à de copieux arrosages...et à des étapes forcées à la gendarmerie...C'est le maire de la commune de résidence qui doit alors se déplacer, pour que le radelier puisse retrouver son foyer ! Le métier est dur, périlleux, et ne fait qu'enrichir les entrepreneurs de flottage.
La Bienne, quand à elle, n'était flottable que sur 18 km, depuis le port de Molinges jusqu'à son confluent avec l'Ain, à Condes. C'était au port de Thoirette qu'était établi le bureau de déclaration des droits de flottage. Les radeaux portaient en surcharge des bois à brûler, des charbons de bois, des perches et bâtons pour la teinturerie, des planches, de la mousse destinée au calfeutrage des bateaux, des "mannes" ou corbeilles en osier.
La crue du 14 Janvier 1899 renversa la grande digue construite en 1870 et le flottage s'arrêta. Entre 1854 et 1856, une moyenne annuelle de 180 radeaux de sapins étaient observée sur l'Ain et 30 sur la Bienne.
![]()
Dominant les falaises de la basse vallée de la Bienne, les plateaux offrent un paysage vallonné composé de prairies calcicoles et de forêts de hêtres. Certaines corniches ensoleillées accueillent l'if ou le chêne. C'est le charme des franges du Haut-Jura : on y passe presque sans transition d'une flore méditerranéenne aux paysages nordiques des tourbières où le bouleau pubescent et le pin à crochet accompagnent une flore arctique. Présent en juillet et en août dans les zones rocheuses, l'apollon est, à coup sûr, l'emblème des pelouses sèches piquées d'orchidées qui envahissent, au sud, les pentes calcaires des plateaux.
![]()
La relative douceur hivernale explique l'ancienneté de l'habitat et celle des cultures introduites par les moines. L'église romane de Saint-Lupicin et la chapelle de Saint-Romain-de-Roche témoignent de ces implantations monastiques. Aujourd'hui, l'agriculture s'efface devant le développement de l'industrie.
![]()
Jusqu'à l'arrivée du chemin de fer, les rouliers grandvalliers, de forte stature, sillonnaient l'Europe à la tête d'attelages de chevaux comtois, vivant de l'exportation des produits du Haut-Jura et du commerce du bois. À l'image du Haut-Jura, le Grandvaux allie aujourd'hui la production fromagère, l'exploitation forestière, la petite industrie et le tourisme de nature
Déja au XVII° siècle, les échevins expliquaient que la pauvreté du sol avait conduit les habitants du Grandvaux à se tourner vers le commerce et l'exportation. Chaque roulier menait quatre à six chariots bachés tirés par de solides chevaux comtois achetés aux foires du Haut-Doubs. Il semble qu'il chargeait d'abord du fromage à livrer dans les viles de plaine. Plus loin, on lui confiait du vin et diverses denrées. Au cours d'un hiver, un roulier pouvait aller jusqu'au Havre, puis jusqu'à Bâle, descendre à Chalon, remonter en Alsace, avant de rentrer. Leurs déplacements étaient organisés, ainsi que les haltes, pendant lesquelles ils prenaient du repos. Vrs 1830, des Grand-Valliers avaient un hôtel à Paris, avec une vaste cour pour les chariots et cent-cinquante places pour les chevaux.
L'equipage pouvait se réduire à une ou deux voitures, conduites par un marchand de "coubic" qui commercialisait cuves, sapines, seaux, grèlets (baquets à lait) de toutes tailles, emboités les uns dans les autres. Tout ce matériel était fabriqué l'hiver, dans les villages de la montagne. Généralement, ce voiturier allait proposer sa marchandise dans les vignobles de la Comté ou du duché de Bourgogne...IL n'oubliait pas de ramener un tonneau de bon vin des régions visitées !
Agissant pour leur propre compte, les roulires dépassaient rarement la quarantaine. Vêtus de deux blouses bleues superposées et d'une culotte en étoffe de laine, ils étaient chaussés de bottes et couverts d'un large chapeau de feutre; à la main, lis tenaient un "chaton", sorte de gros gourdin, destiné à décourager d'éventuels agresseurs.
Tant qu'il entendait les sonnailles du cheval du dernier chariot, le roulier progressait sans inquiétude. Sous la première voiture étaient rangés les outils nécessaires à toute réparation; une caisse blindée, fermée à clé, renfermait papiers et objets de valeur.
En 1840, les équipages étaient encore évalués au nombre de 150 à 170, soit plus d'un millier de chevaux. A lui seul, le village de Saint-Pierre en comptait 420. Si la maison Alfred Bouvet racheta queques entreprises de roulage, c'est le train, entre 1890 et 1910, qui porta le coup fatal à cette activité typiquement haut jurassienne.
Alfred Bouvet,important entrepreneur de roulage puis de voiturage du bois, faisait encore travailler des centaines d'homme à cette époque. Aujourd'hui l'histoire des rouliers appartiend au passé; un passé riche de prouesses et d'anecdotes, relayé par des hommes comme Louis Chamu et ses autocars grandvalliers, ou Marcel Bouvet-petit fils d'Alfred-, fondateur de l'entreprise Jura Transport il y a une cinquantaine d'années...
![]()
Isolé dans la montagne, l'homme du Haut-Jura a toujours été prévoyant. Les fermes sont solidement bâties, prêtes à accueillir le bétail et les provisions. Mais le feu prenait facilement dans ces demeures construites avec le bois des joux voisines. Mème les pèlerinages à Saint-Claude, les prières et les processions, ne suffisaient pas à enrayer ce fléau. Aussi le fermier eut l'idée d'établir à proximité de sa ferme, pas trop près cependant, un petit édifice : le <<grenier fort>>.
Construit de bois en grande partie, sur un soubassement de pierre, il est soigneusement fermé par une bonne serrure de fer. Il est parfois décoré de la pointe du couteau. L'un a sculpté une date, l'autre des noms ou des scènes. Les Jurassiens du Haut-Jura gardaient là leurs objets précieux, leurs grains, ce qui permettait de faire repartir la vie si un drame survenait.
Les greniers forts sont nombreux des Bouchoux à Septmoncel, vers La Joux, Lamoura, Longchaumois; on en découvre aussi ça et là dans le secteur de Prémanon et des Rousses...
![]()
L'identité des Hautes-Combes - le sud-est du parc, de Lajoux à Belleydoux - se révèle véritablement quand vient l'hiver et que la neige aplanit l'espace, invitant les fondeurs aux longues randonnées. Frontière entre les pâturages et les forêts pâturées, les pré-bois, qui se couvrent l'été de gentianes, attirent les mushers et leurs traîneaux à chiens, ou encore les adeptes de la balade à raquettes. Dès la fonte des neiges, les hautes terres sont brusquement livrées à l'été qui se manifeste par l'éclosion soudaine d'une flore variée. C'est sans doute pourquoi Fernand Braudel prétendait "reconnaître le Jura à la seule couleur de ses herbages, où un bleu subtil se mélange obstinément à un vert profond et acide, éclatant". Avec l'estive des troupeaux, l'espace des combes retentit du son des clarines qui possèdent toute leur sonorité propre, spécifique à chaque éleveur
![]()
Le grand tétras
Cet oiseau imposant et farouche recherche la tranquillité des forêts d'altitude : arbres perchoirs et aiguilles de sapin pour sa nourriture l'hiver ; clairières pour les parades amoureuses au printemps ; fourrés aux premiers jours de la nichée ; buissons de myrtilles pour sa provision d'énergie à l'automne. Le devenir de cet oiseau dépend d'une sylviculture douce en futaie jardinée assurant la diversité des peuplements, et de l'étagement de la végétation. Les massifs du Massacre et du Risoux font ainsi l'objet de mesures de protection qui visent à limiter leur fréquentation de décembre à juin.
La grande traversée du Jura.
En hiver, la piste balisée de la GTJ permet aux amateurs de ski de fond de traverser le parc de Giron, à l'extrême sud, jusqu'à Chapelle-des-Bois, village le plus septentrional (en haut, son écomusée), en passant par les quatre villages de la station des Rousses. Un circuit équivalent est ouvert aux VTT durant la belle saison.
Le relief jurassien
Au milieu de l'ère secondaire, le jurassique correspond à la mise en place des dépôts sédimentaires marneux et calcaires. Au cours de l'ère tertiaire, les phases de formation des Alpes génèrent des poussées latérales sur le Jura. Les roches se plissent en une alternance de monts et de vaux, compliquée par des systèmes de failles et de chevauchements. L'action d'érosion des glaciers et de l'eau vient sculpter ces formes au quaternaire. Les eaux lacèrent les dalles en "lapiaz", minent le sol de "dolines", ou "empossieux", qui se rejoignent parfois en "ouvalas". Il arrive qu'une rivière force le passage d'un mont en taillant une "cluse". Elle peut aussi disparaître pour laisser une "vallée sèche", et réapparaître en aval sous forme de "résurgence". Le terme de "combe" désigne localement toute forme de dépression linéaire concave, que peuvent encadrer des "crêts".
B. Clavel
"Le Grandvaux prend sa couleur d'automne avec la rouille des embouches et celle plus sombre des premiers labours. Les sapins paraissent plus noirs. [...] Les soirs sont souvent violets avec beaucoup de braises ardentes."
Le paysage acoustique
En raison de son relief constitué de multiples dépressions, le paysage du Haut-Jura est propice à la propagation des sons. La roche calcaire, omniprésente, et l'existence de nombreuses caisses de résonance naturelles (grottes, galeries...) viennent encore amplifier le phénomène. C'est ainsi que beaucoup de points de vue sont également de remarquables points d'ouïe.
La Maison des fromages
La qualité des herbages du Haut-Jura a donné naissance à des fromages de grande renommée : le comté des fruitières, le morbier au lait cru et le bleu de Gex (appelé aussi bleu du Haut-Jura ou septmoncel), qui a la réputation d'avoir été le fromage préféré de Charles Quint !
![]()